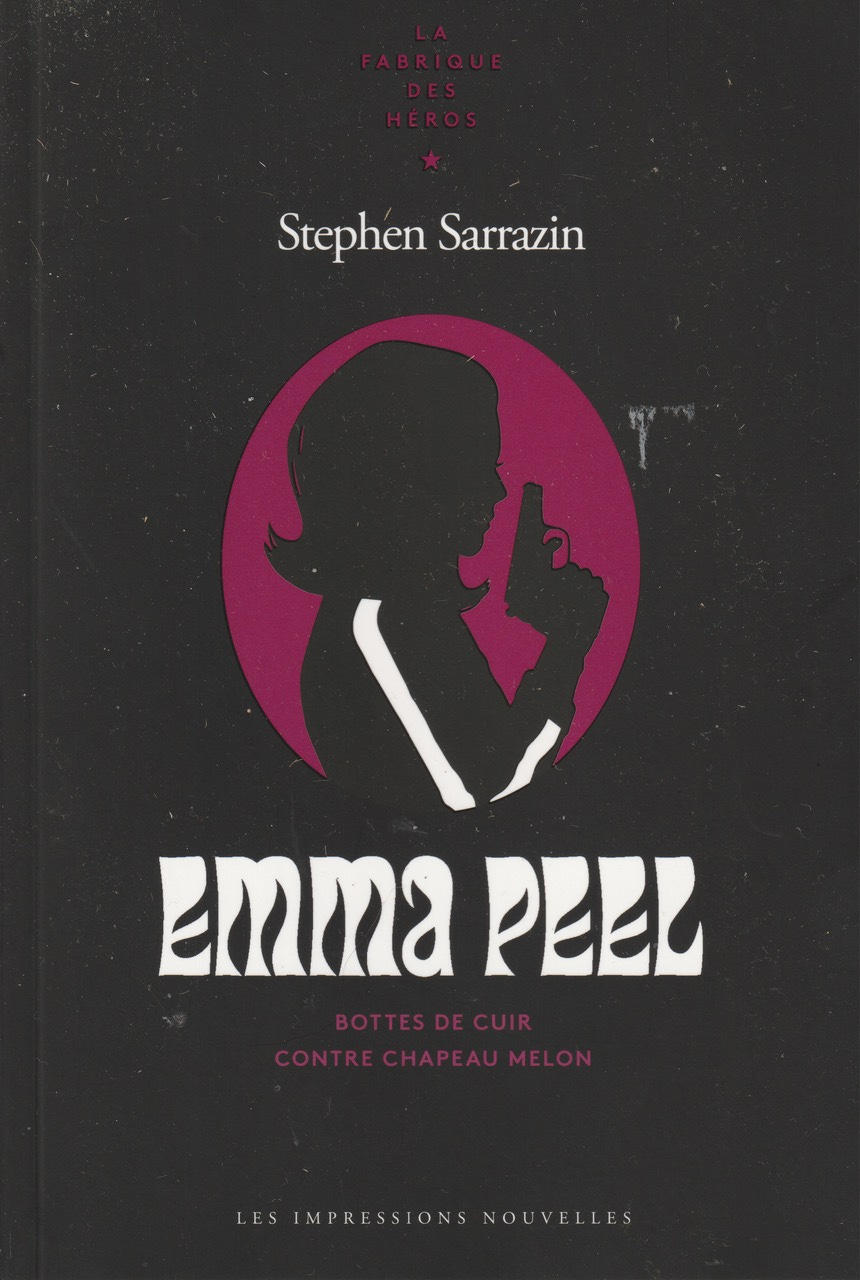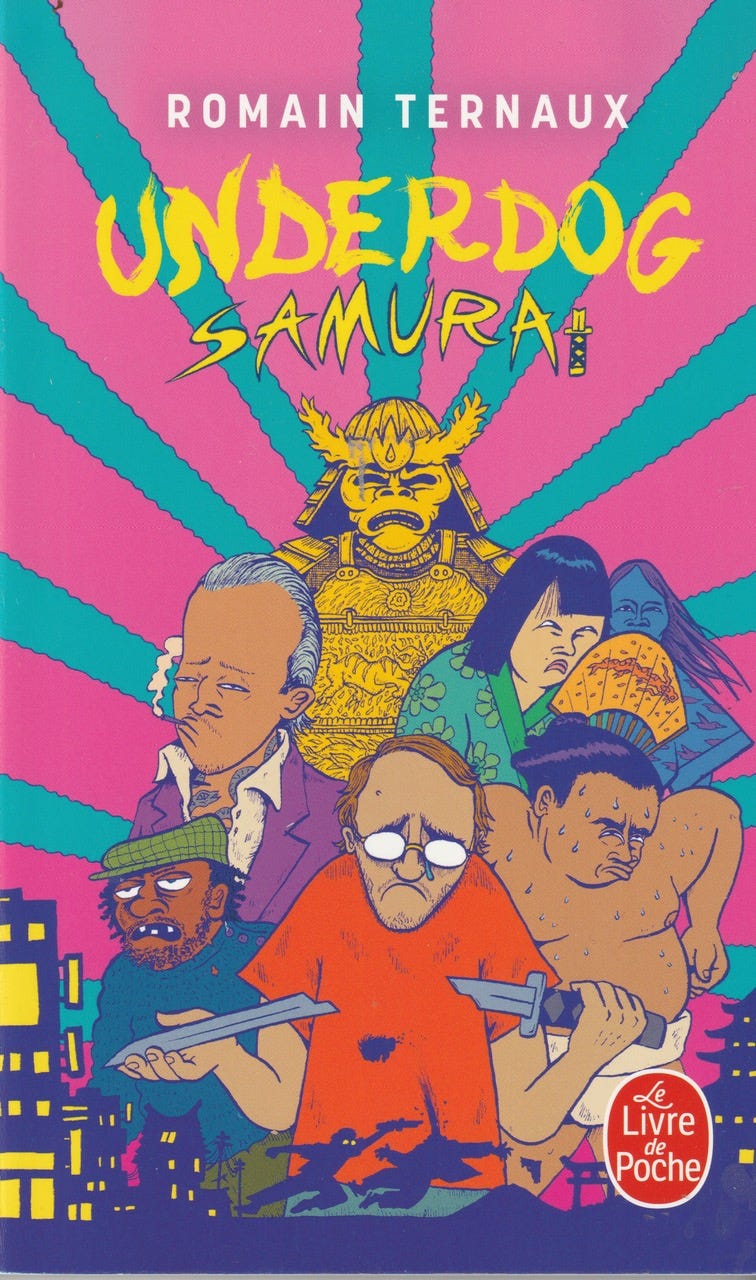ATTENTION L’EARLY BIRD SERA EPUISÉ CE WEEKEND !
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/lincalinfini
AMYTIVILLE, QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Le 13 novembre 1974, la police d’Amytiville, petite ville paisible de l’État de New York, découvre les cadavres de six membres de la famille DeFeo, le père, la mère et quatre enfants, tous tués d’une balle dans la tête ou le cœur, et reposant chacun dans leur lit. Seul survivant, le fils aîné, Ronald, dit « Butch » est suspecté et vite arrêté, d’autant qu’il se livre à des aveux, prétendant avoir été possédé par des forces maléfiques. Il sera condamné à six peines de prison à vie, et décède en 2021, gardant son secret. L’affaire d’Amythiville a secoué les États-Unis, donnant lieu, en 1979, à un premier film (qui sera suivi de bien d’autres) signé Stuart Rosenberg, qui opte pour une version fantastique reprenant quelques Fake News de l’époque, comme la possession de Butch par les esprits des Indiens du cimetière duquel se dresse la bâtisse. Mais quelle est la vérité ? C’est pour la découvrir que le journaliste Ric Osuma a mené une longue enquête, livré en 2002 dans L’Affaire Amytiville, le meurtre de la famille FeFero, qui vient seulement d’être traduit. 350 pages qui rendent compte de toutes les incohérences de l’enquête (il parait impossible que ce sextuple meurtre ait pu être commis par une seule personne) et donne in fine le point de vue de l’auteur… que nous vous laissons découvrir, dans un ouvrage passionnant illustré de nombreuses photos, dont certaines datant du jour-même du meurtre (Okno).
LAURENT GENEFORT EN IMAGES
Notre meilleur auteur national en space-opera ne pouvait qu’un jour ou l’autre, vu le foisonnement de ses univers, être mis en images. En attentant le 7e art, ce qu’on lui souhaite, la bande dessinée lui a donc mis le grappin dessus. Ainsi, après “Peaux-épaisses” et “Le Sang des Immortels”, deux albums de 2021, voilà Chasseurs de sèves, qui lui aussi est l’adaptation d’un de ses romans, ce dont Genefort laisse toute liberté à d’autres que lui. Ce troisième album, signé texte et dessin par Alexandre Ristorcelli, qui vient du cinéma d’animation et a partagé la couleur avec Annelise Sauvêtre, se déroule sur l’Arbre-Monde, un arbre gigantesque dont les ramures couvrent une bonne partie de la planète Yeisshajar, et où vivent divers clans antagonistes. Mais la sève nourricière de l’arbre commence à dépérir. D’où vient le mal ? C’est ce qu’un jeune guerrier, Pierig, va tenter de découvrir en compagnie d’une guerrière dont il est le prisonnier, et bientôt l’amant, Eva. D’où une très longue balade entre ciel et terre, à travers les branches qui recèlent moults dangers, dont nombres d’animaux féroces dont Genefort, à l’image de son maître Stefan Wul, aime à parsemer ses récits, comme des lynx géants et cet horrible arachnide nommée spitake. Si la base du décor et du récit remontent incontestablement au “Monde vert” de Brian Aldiss, la résolution graphique qu’y apporte Ristorelli est en tous points remarquable, avec un dessin réaliste fouillé jusqu’au moindre détail, un art de paysagiste sachant nous perdre avec les personnages dans les entrelacs de l’Arbre-Monde, et une gamme de couleurs aux délicats brun verdâtre pleine de poésie. Une réserve néanmoins : si les péripéties s’accumulent, le récit reste très linéaire et, partant d’un court roman, les 112 pages que compte l’album n’étaient peut-être pas nécessaires. Mais au moins, c’est une fête pour les yeux (Les Humanoïdes associés).
MÉTAL HURLANT, SIXIÈME MARCHE
Le Mook créé jadis par Jean-Pierre Dionnet, Druillet et quelques autres a incontestablement réussi sa résurrection, et vogue sur son rythme trimestriel de croisière. Avec son n° 6, épais comme il se doit de 272 pages, c’est à un magnifique palmarés des années 70 et 80 que nous sommes conviés. S’il serait trop long de tout citer, piochons quelques perles : en premier lieu Polonius, rare fantasy gréco-romaine de Tardi (sur un scénario) de Picaret, 19 planches en noir et blanc tramé réjouissantes ; l’indispensable Mœbius qui, avec L’Univers est bien petit, nous brosse un court space opera schecklyen bien dans sa manière ; Machine célibataire, ou la femme et le robot, que Nicolet, plus peintre que bédéiste, délivre en huit planches magnifiques ; Chantal Montellier, plus politique que jamais avec L’esclavage c’est la liberté et qui, avec sa rage froide, se réfère à Orwell ; en vedette incontestée enfin, Philippe Druillet qui, avec Gail (1Ç78) très sombre quant au fond, éblouissant par les couleurs plaquées sur ses doubles-pages aux détails microscopiques, traversait à l’époque une période tragique suite à au décès de sa femme Nicole. Le tout présenté en duo par notre ex-collaborateur Claude Ecken et Christophe Quillien, d’autres texte nous rappelant l’expérience du Heavy Metal américain, tandis que Serge Clerc nous livre ses mémoires illustrés de nombreux dessins et d’une courte bande. Comme on l’a compris : à ne pas manquer (Les Humanoïdes associés).
MILLE ANS DE MOYEN ÂGE À LA TÉLÉ
C’est sous le titre Un Moyen âge en clair-obscur, sous-titré Le médiévalisme dans les séries télévisées, que Justine Breton, maître de conférence en littérature française à l’Université de Reims, s’attaque à une étude qu’on va dire costaude (398 pages) sur une période historique qui s’étends sur 1000 ans, et étudiée à travers 81 séries, de 1949 (The Adventures of Sir Galahad) à 2022 (Vikings : Walhalla). Ceci en s’attachant à débusquer le vrai du faux, que ce soit volontaire ou non, et en s’attachant en premier lieu à cette représentation voulant que « toutes ces séries puisent dans un même imaginaire : celui de nobles chevaliers faisant parler le fer dans un monde à la fois merveilleux et violent ». D’où le mythe d’un « âge sombre » régi par saleté, les combats, et où le travail serait inexistant, « les paysans toujours limités à des rôles secondaires, voir le plus souvent à un simple statut de figurants ».
Justine Breton va du plus connu (les armures plates en usage à partir du XIVe siècle seulement revêtant les chevaliers de la Table ronde) à l’historicité la plus pointue : quand il s’agit du IXe siècle, on doit évoquer les Danois plutôt que les Vikings, ce que fait par exemple The Last Kingdom de Stephen Butchard que l’autrice cite comme modèle de réalisme. Comme quoi les séries ne surfent pas seulement sur des bévues ou l’anachronisme – à moins qu’il ne soit voulu (Kaamelott) – même (sic) la place des femmes commençant à émerger (Cursed : La Rebelle). Extrêmement détaillé et donc passionnant, cette étude omet le plus souvent de citer les auteurs des œuvres, ce qui est dommage, de même qu’un ouvrage incluant les films de cinéma aurait été utile – mais alors il lui aurait fallu doubler de volume, et puis cela a déjà été fait ailleurs (Presses universitaires François-Rabelais).
EMMA PEEL EST DIANA RIGG
On se souvient d’elle pour sa première apparition dans Chapeau melon et bottes de cuir (The Avengers). C’était en 1965, dans l’épisode The Town of no Return, réalisé par Roy Ward Baker où, succédant à la blonde Elizabeth Shepherd à l’orée de la quatrième saison de la série, elle va être la fidèle compagne de John Steed trois saisons durant, imposant sa combinaison de cuir moulante et les longues bottes noires qui vont vite être caractéristique du Swinging London. Féministe déjà ? Sans doute pas, mais s’imposant en tout cas à l’égal de son partenaire Patrick McNee. Emma Peel, c’est Diana Rigg, jeune actrice de théâtre qui restera à jamais dans la mémoire des téléspectateur, comme une séductrice au charme d’autant plus ravageur que contenu, et qu’on quittera avec regret en 1968, pour l’épisode The Forget-Me-Knot où, pour la première fois et en guide d’adieu, elle pose ses lèvres suaves sur la joue de Steed. C’est cette aventure que le critique Stephen Sarrazin raconte dans Emma Peel, court récit d’une centaine de pages qui ravira, et ravivera les souvenirs de beaucoup (Les Impressions nouvelles).
UN PEU DE LECTURE EN POCHE
Comme nous le faisons ici régulièrement, nous allons faire un tour rapide des poche récents. À commencer par Symphonie atomique, signé du Français Étienne Cunge qui nous raconte comment, à la fin siècle, l’espace circumterrestre étant bourré de satellites américains, russes et chinois porteurs d’ogives nucléaire, un rien peut déclencher la Der des der. À la fin du siècle seulement ? Voilà donc un roman optimiste (Pocket). Chez le même éditeur, et français également, Le Chant des glaces, de Jean Krug, imagine que sur la planète glaciaire Delas, des milliers de prisonniers forent les glaciers pour alimenter en eau potable le reste de la galaxie. Voilà la solution à la sécheresse qui s’annonce ! Pocket toujours mais de l’auteur chilien vivant à Paris Gilberto Villarroel, Lord Cochrane et le trésor de Selkirk fait vivre, en 1822, l’authentique commandant de la flotte chilienne pour une histoire de chasse au trésor sur l’île de Robinson Crusoe, qui serait en fait la demeure de l’abominable Chtulhu. 600 pages de fantasy haute en couleur. On passe au Livre de poche avec le noir-américain Nana Kwame Adjei-Brenyah pour Friday Black, où la fièvre acheteuse de ce jour béni tourne en apocalypse où le racisme est pointé du doigt, un récit furieux où ne manquent même pas les zombies jetés dans l’univers de Ballard. Romain Ternaux lui, nous entraîne au Japon, à la suite du narrateur qui s’est fait rouler en achetant un katana sur Internet. Mais ça ne va pas se passer comme ça ! Underdog Samurai n’hésite pas à mêler humour trash et mysticisme, avec un résultat qui dépote (Le Livre de poche).
JEAN-PIERRE ANDREVON